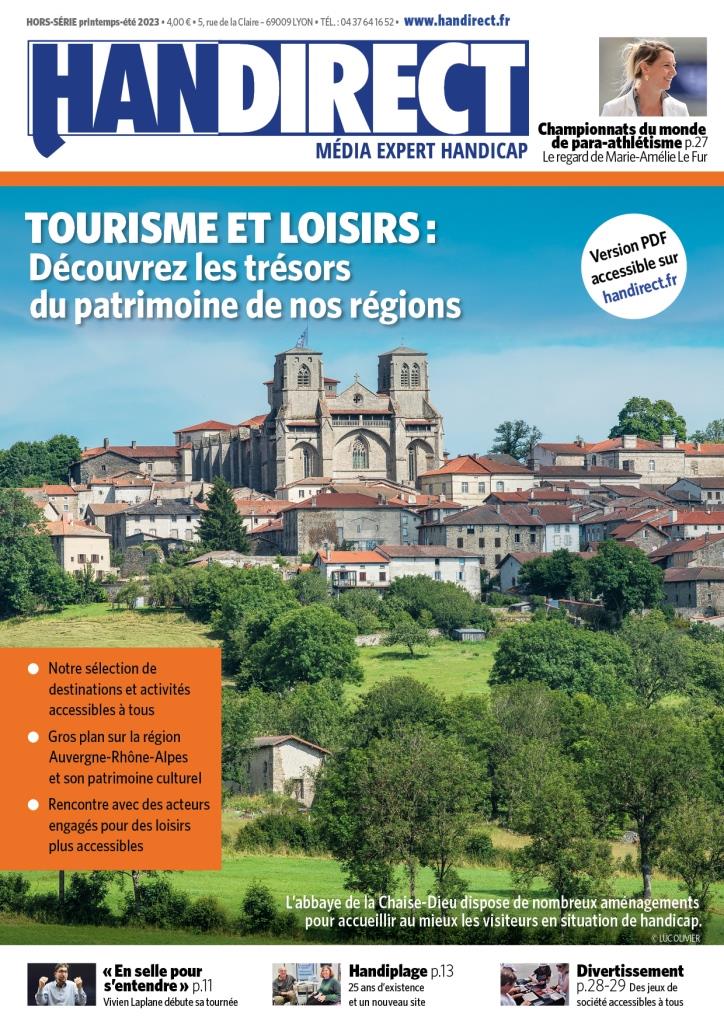Sexualité des personnes en situation de handicap : Entre protection et liberté, un cheminement complexe et paradoxal
Rencontre avec Jennifer Fournier, professeur associée à la Haute École de Travail social et de la Santé de Lausanne en Suisse et auteure de la thèse « La vie intime, amoureuse et sexuelle à l’épreuve de l’expérience des personnes en situation de handicap. L’appréhender et l’accompagner ». Nous lui avons demandé de faire un état des lieux de la sexualité des personnes en situation de handicap en France aujourd’hui.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai fait un doctorat en Sciences de l’Éducation sous la direction du professeur Charles Gardou – doctorat qui portait sur l’expérience de l’intimité et de la sexualité des personnes en situation de handicap, et sur l’accompagnement des professionnels autour de ces mêmes dimensions.
J’ai été chargée de cours à l’université, intervenante dans les écoles de travail social en France. J’avais en parallèle une pratique de formatrice indépendante dans les établissements médico-sociaux : j’intervenais auprès des équipes de professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap, et j’étais animatrice de groupes de parole, d’expression, d’échange… pour des personnes en situation de handicap et des parents.
J’ai également été chargée de recherche pour le programme « Mes amours » qui concerne les personnes ayant une déficience intellectuelle.
Depuis septembre 2017, j’occupe un poste de professeur associée à la Haute École de Travail social et de la Santé de Lausanne en Suisse. Mes interventions portent sur la question du handicap et s’adressent à des étudiants qui se destinent à des postes de travailleurs sociaux (éducateurs, assistants sociaux, animateurs socio-culturels…).
Pouvez-vous nous parler du sujet de votre thèse ?
Je me suis intéressée à l’expérience de personnes en situation de handicap qui ont une déficience motrice importante et qui vivent en établissement – leur expérience dans le champ de l’intimité et de sexualité. Ma préoccupation première était de tenter de comprendre ce qu’elles vivent, ce qu’elles éprouvent, quels sont leurs souhaits et préoccupations. C’est vraiment elles qui sont au centre de mon travail. Or, comme les personnes que j’ai rencontrées dans le cadre de mon doctorat sont très dépendantes pour tous les gestes de la vie quotidienne, très vite est arrivée la question suivante : « Qu’en est-il des professionnels qui les accompagnent ? ». J’en suis arrivée à une question centrale dans mon travail. J’ai constaté qu’il y avait un écart entre ce que disent les personnes ne situation de handicap vis-à-vis de l’intimité et de la sexualité, et ce que disent les professionnels qui les accompagnent. Je me suis donc interrogée sur : « Pourquoi cet écart et comment le comprendre ? ».
Quelles sont les attentes des personnes que vous avez accompagnées ?
Ce qui est commun aux différentes personnes que j’ai croisées, qu’elles aient une déficience intellectuelle ou motrice, c’est leur souhait de pouvoir rencontrer quelqu’un, de vivre une grande histoire d’amour, et éventuellement de se marier et d’avoir des enfants. Des attentes ou des souhaits qui sont tout à fait ordinaires et qui sont ceux du commun et de la majorité. Ce qu’on mesure lorsqu’on travaille sur ces questions-là c’est que vraiment ces personnes ont le souhait d’investir la dimension de la sexualité et de la vie amoureuse comme quelque chose de positif dans leur vie, que c’est important pour elles, et que c’est une dimension qui compte.
Du coup si les attentes se portent sur des points identiques, corrélativement, les difficultés sont liées à la solitude, à la difficulté de rencontrer une compagne ou un compagnon, aux relations de conflits, ou aux séparations. Et là aussi c’est infiniment commun et ordinaire.
C’est intéressant car le fait d’entrer par la question de la sexualité, de l’intimité, de la vie amoureuse, cela fait qu’on aborde toutes ces choses, souhaits et difficultés, qu’on a en commun qu’on ait une déficience ou pas.
Avez-vous remarqué des difficultés spécifiques pour les personnes avec qui vous avez travaillé ?
Oui, j’ai aussi constaté des difficultés spécifiques ou des empêchements singuliers. Par exemple, les personnes qui ont une déficience motrice voient cet aspect comme un obstacle majeur à la possibilité de faire des rencontres, à certaines pratiques amoureuses ou sexuelles. Dans un groupe, une femme me disait : « Quand deux personnes en fauteuil veulent s’embrasser, elles ne peuvent pas le faire ». Une autre femme expliquait que « la déficience motrice peut être vécue comme une fragilité par rapport aux situations d’abus », « si on me retire de mon fauteuil, je ne peux plus partir donc il faut qu’on respecte vraiment ce que j’ai à dire, et donc je me sens plus fragile et en risque d’être abusée ». Cela peut donc susciter des craintes, sachant que cette problématique du risque d’abus est une inquiétude majeure pour les parents d’adultes que j’ai rencontrés, quelle que soit la déficience de leur enfant. C’est toutefois une réalité et ces craintes ne sont pas imaginaires. La dernière enquête dont j’ai pris connaissance est une étude américaine de 2011 qui établit que les hommes en situation de handicap sont quatre fois plus souvent victimes d’abus sexuels que les hommes ne déclarant pas de déficience ; et que les femmes en situation de handicap sont deux fois plus souvent victimes d’abus sexuels que les autres.
Il faut noter par ailleurs que les hommes sans déficience déclarent peu de situations d’abus, ce qui peut expliquer l’écart important.
Autre difficulté : Que la déficience soit motrice ou intellectuelle, les personnes avec qui j’ai travaillé connaissent mal leur corps et son fonctionnement. Cela peut donner lieu à des confusions et des peurs, par exemple certaines femmes ne savent pas à quel moment elles peuvent tomber enceintes, donc elles ne font jamais l’amour, par crainte. Autre situation, un jour alors que l’on montrait à un groupe une image de sexe d’homme et une représentation du sperme, une participante a interprété en disant : « Ça c’est le Sida ». Ces méconnaissances ont un impact direct sur la vie sexuelle et les pratiques amoureuses. Toutefois il ne faut pas généraliser, on parle ici des personnes que j’ai rencontrées dans le cadre de mes recherches. De même, je n’ai pas fait de recherches sur des personnes n’ayant pas de déficience, donc je ne suis pas sûre que si l’on demande à un public de personnes dites valides de dessiner un clitoris elles soient toutes capables de le faire, de même sur le thème de la contraception ou des infections sexuellement transmissibles.
Parfois les difficultés sont peut-être différentes selon le type de déficience…
Effectivement, parmi les personnes que j’ai côtoyées, notamment des personnes déficientes intellectuelles, beaucoup connaissent mal les droits et les interdits en matière de sexualité sont mal connus. On peut ainsi se retrouver avec des personnes qui ont des pratiques peu adaptées et hors la loi (consommation de pédopornographie, se masturber dans des espaces collectifs ou publics…), des pratiques qui ne sont pas correctes au regard de la loi. Mais cela pose aussi le problème de personnes qui ne connaissent pas leurs droits et qui du coup ne peuvent pas les faire valoir. C’est le cas lorsque quelqu’un découvre lors d’un groupe de parole, que ce qui s’est passé s’appelle un viol et que c’est interdit.
Également du côté des personnes qui ont une déficience intellectuelle, on s’est aperçus à travers le programme « Mes amours » que beaucoup de personnes ont des difficultés à reconnaître leur propre état émotionnel, celui des autres autour d’eux. Elles ont du mal à ajuster leur comportement par rapport à l’autre, à comprendre que l’autre est différencié, et que lorsqu’on veut quelque chose l’autre ne veut pas forcément la même chose. Lorsqu’on est heureux, l’autre peut être triste… Sur un plan relationnel, cela peut causer des malentendus, et sur le plan de la sexualité cela peut conduire à une situation où l’un des deux n’est pas forcément d’accord avec ce qui est en train de se passer.
Par ailleurs, pour les personnes déficientes motrices avec qui j’ai travaillé, la vie en établissement est un parcours d’obstacles. Elles évoquent l’absence de confidentialité, d’intimité, la peur d’être surpris, que tout se sache… Elles expliquent aussi qu’il y a de nombreuses règles de fonctionnement (heures de repas, de lever, de coucher…) qui viennent complètement en contradiction avec la possibilité d’avoir une vie de couple. Elles dénoncent un certain nombre d’interdictions, pas forcément énoncées, mais vécues comme telles. Par exemple, dans les groupes de parole que j’ai animés, les personnes se demandent si elles ont le droit de faire l’amour ; elles disent qu’il est interdit de s’enfermer à clef dans sa chambre pour plus de sécurité… Et ces interdictions sont tellement ancrées qu’elles ne mettent pas les personnes en lutte. Certaines règles ont peut-être été énoncées il y a très longtemps et n’ont plus lieu d’être aujourd’hui, mais elles continuent d’exister parce que les gens les ont intégrées, et aussi, parfois, parce que les professionnels ne sont pas facilitateurs. Là non plus il ne faut pas généraliser, mais certaines personnes évoquent parfois des paroles humiliantes. Et il est très difficile pour elles de s’opposer, car, comme elles l’expliquent très bien, quand on est dépendant d’un professionnel pour tous les gestes de la vie quotidienne, s’il est fâché, le soin va être beaucoup moins agréable (sans parler forcément de maltraitance ou de gestes inadéquats) … quand la dimension relationnelle n’est pas là, c’est tout à fait désagréable.
Selon vous, quelles mesures ou changements pourraient permettre d’y remédier ?
Vu le métier que j’exerce, je reste intimement persuadée que la question de la formation est centrale. Elle est nécessaire mais non suffisante.
Je pense que les établissements qui accueillent beaucoup de personnes sont probablement plus à risque de ne pas respecter ni l’intimité, ni la vie privée, ni la sexualité des personnes qui sont accueillies – plus que les petites unités de vie ou les colocations. Les gros établissements fonctionnent avec toute une organisation à mettre en œuvre et qui du coup rend difficile la prise en compte des personnes singulières, de leurs préoccupations, de leur rythme de vie.
Je pense aussi que les cadres ont un rôle important à jouer dans ce qu’ils impulsent comme valeurs, missions et pensées dans les équipes.
Du côté des personnes en situation de handicap, pour moi l’une des pistes serait de s’organiser collectivement pour dire ce qui est bon pour elles, et que cette démarche soit soutenue par les parents, proches et associations. Tant qu’elles restent seules avec les difficultés qu’elles rencontrent, les personnes sont un peu broyées dans le système et ont du mal à faire avancer les choses.
Pour avoir participé au programme « Mes amours », dans lequel des personnes en situation de handicap deviennent elles-mêmes formatrices pour d’autres, il me semble que toute la question du pair-accompagnement et de la paire-formation fait partie des pistes de travail à développer.
Dans les mœurs, la sexualité des personnes handicapées a longtemps été considérée comme taboue, voire dangereuse… La situation a-t-elle évolué aujourd’hui ?
Je pense que oui, au sens où ça a été pendant longtemps un secret absolu – cela n’existait pas. Cela ne pouvait pas exister. Aujourd’hui il n’y a plus cet interdit aussi fort. On reconnaît de mieux que ça existe, que c’est légitime, que l’on ne peut pas empêcher les personnes de vivre ces dimensions de leur existence.
On se rend compte aussi – que ce soit du côté des militants en situation de handicap, ou de la prise en compte par les institutions politiques de ces revendications – que les revendications portent d’abord sur les dimensions de la vie sociale (revenu digne, un logement, un emploi, accéder à du sport et de la culture…). C’est seulement dans un second temps que les revendications et la prise en compte des dimensions plus intimes et personnelles est arrivée. Donc oui, ça bouge, mais certainement pas assez vite pour les personnes concernées. En parallèle, de plus en plus de formations ou de colloques sont proposés sur ce thème. Après il reste du travail, car le tabou et la dangerosité sont des représentations qui continuent d’exister. Il y en a d’autres qui arrivent : « C’est une bonne chose », « On ne peut pas empêcher les gens » … mais les représentations plus anciennes continuent d’exister malgré tout.
Et qu’en est-il de l’assistance sexuelle ?
Dans les groupes de parole que j’ai animés, la question n’est presque pas apparue. Donc j’aurais tendance à penser, c’est un avis personnel, que c’est une réponse parmi d’autres, mais ni plus ni moins qu’une réponse comme peut l’être la prostitution pour beaucoup d’autres gens… c’est-à-dire pas du tout en lien avec les aspirations de la majorité. C’est un peu l’arbre qui cache la forêt. L’assistance sexuelle est devenue une question publique, celle qui arrive toujours au devant de la scène, mais je trouve que quand on en parle avec des personnes en situation de handicap, ce n’est vraiment pas ça qui arrive en premier.
Le développement d’une vie amoureuse heureuse dépend-t-il forcément d’une vie sexuelle active ?
Je pense que non, absolument pas. On peut même penser qu’il est tout à fait possible de vivre une vie amoureuse et sexuelle séparée. De même, une vie sexuelle heureuse ne dépend pas d’une vie amoureuse. Il y a des personnes pour lesquelles la sexualité va se déployer du côté du corps, d’autres pour lesquelles ça va se déployer plutôt de la tête (rêves, phantasmes…) et y rester, d’autres pour lesquelles ça va se déployer via des sentiments, via la dimension affective… avec des relations platoniques, et d’autres pour lesquelles toutes ces dimensions-là seront reliées, le corps, la tête et le cœur… Mais pas tout le temps et pas pour tout le monde. Et j’estime qu’il n’y a pas de hiérarchie dans la façon dont ça s’exprime pour chacun, que la personne soit ou non en situation de handicap.
Que ce soit pour les proches de personnes déficientes intellectuelles, ou pour les professionnels qui les côtoient au quotidien, comment trouver le juste équilibre entre une surprotection liée à leur vulnérabilité, et la liberté de chacun à vivre une vie affective épanouie ?
Ce que j’ai constaté à la fois à travers ma thèse et le programme « Mes amours », auprès de personnes déficientes intellectuelles ou déficientes motrices, c’est la centralité et l’importance de la place des parents et de la famille. C’est une ressource, ceux sur qui on peut compter, une référence centrale dans le discours des personnes adultes. Parallèlement à ça, c’est aussi « à cause d’eux » qu’il leur est difficile de se construire une « vie pour soi ». C’est tout le paradoxe : la famille est à la fois un facilitateur et une référence pour les personnes, et un obstacle important. Du coup il est très difficile de trouver un équilibre entre surprotection et liberté. On ne trouve jamais ce juste équilibre. Si on dessine une ligne représentant le paradoxe, en plaçant à un bout la surprotection, à l’autre bout la liberté ; que l’on soit parent ou accompagnant professionnel, on passe son temps à bouger le curseur sur cette ligne en fonction de la personne, des moments… Dès le moment où la personne va très bien, on va se mettre du côté de la liberté, et dès le moment où la situation est plus compliquée on revient du côté de la surprotection. Le souhait de liberté rejoint donc la prise de risque, car pour être libre on prend des risques, on ne peut pas faire autrement. Si on fait disparaître la liberté, on est maltraitant, et si on fait disparaître la protection, on est maltraitant aussi. On est donc obligé de tenir les deux en même temps, d’où le paradoxe.
Y-a-t-il des projets innovants et/ou prometteurs dont vous avez entendu parler et dont vous souhaitez nous parler ?
Je pense que le programme « Mes amours » fait partie des projets novateurs et à défendre. C’est-à-dire un projet développé non pas pour les personnes en situation de handicap mais avec elles, et qui soit géré par elles-mêmes dans la durée. Cela va également dans le sens de l’émancipation car cela permet de faire du collectif, de laisser les personnes concernées prendre des positions valorisées et donc valorisantes, de développer des compétences…
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Auprès des personnes avec qui j’ai travaillé, j’ai constaté une tension par rapport au souhait d’être et de faire comme tout le monde. En effet, c’est un aspect qui soutient l’émancipation des gens et c’est en même temps quelque chose qui les enferme. Du coup la question de la norme et de la normalité, du validisme et du capacistisme, est rarement pour dire jamais interrogé. « Ce qui est bon est ce qui est normal », mais finalement on n’interroge jamais ce qui est normal. Par exemple on ne se demande pas pour quelle raison les personnes qui ont plus de capacités physiques ou intellectuelles sont toujours considérées comme supérieures aux personnes qui en ont moins. Cette aspiration à la normalité est à la fois quelque chose de porteur, et à la fois un vrai enfermement car il y a aussi beaucoup de situations où faire et être comme tout le monde n’est pas possible, ou pas souhaitable.
Vous pouvez consulter la thèse de Jennifer Fournier : « La vie intime, amoureuse et sexuelle à l’épreuve de l’expérience des personnes en situation de handicap. L’appréhender et l’accompagner » via ce lien : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/fournier_j#p=0&a=top