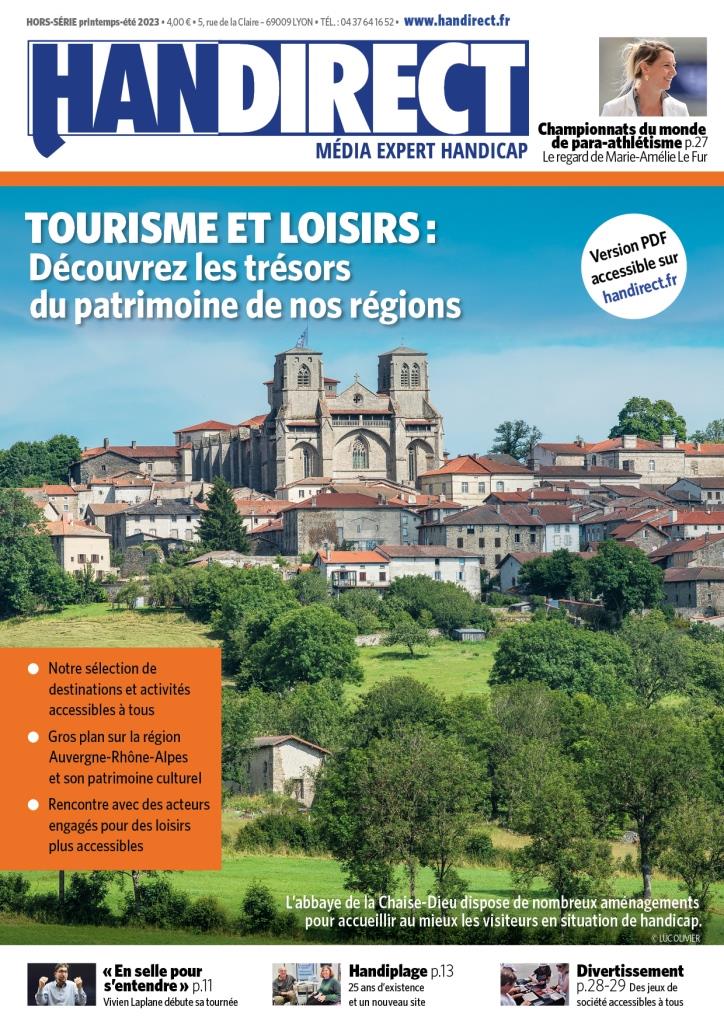Le handicap dans le droit français : Entre réparation du lien social, indemnisation du manque à gagner et compensation des préjudices corporels
Par Eve Gardien, Maître de conférences en Sociologie, Université Rennes2, ESO (UMR 6590)
Les droits des personnes handicapées, en France comme à l’international, sont le fruit d’une histoire. Dès l’Antiquité, des réglementations s’appliquent au handicap. Mais lesquelles ? Concernant quelles incapacités ? Avec quelles finalités pour la société ? Selon quels critères ? Cet article nous invite à découvrir cette histoire, également à comprendre l’évolution de la prise en compte du handicap au fil des débats qui ont structuré nos sociétés.[1]
La réparation du handicap ou la réparation du lien social
D’aussi loin que l’analyse des documents anciens a permis de remonter dans le temps, la pratique consistant à donner un bien matériel -en nature ou en pièces trébuchantes- en réparation d’une lésion corporelle et de ses conséquences, semble avoir toujours existée. Par exemple, un droit à réparation, proportionnelle à la valeur de la partie corporelle perdue, est explicitement instauré dans la Tablette de Nippur dès 2500 avant JC (Geerts, 1962). Nous retrouvons également cette pratique de tarifications des parties corporelles lésées dans la civilisation babylonienne – le code d’Hammourabi (-1750 avant JC) -, dans diverses contrées orientales – l’Avesta (- 600 avant JC) -, ou encore dans le corpus juris germani (500 après JC), dans les coutumes franques, dans le code danois Knud (1000 après JC), etc.
Cette valeur (monétaire bien souvent) accordée au corps blessé et à ses parties est un construit social, autrement-dit est le fruit de négociations entre acteurs au regard de ce qui fait sens pour une société donnée. A chaque milieu culturel, à chaque époque, ses spécificités en matière de forfaitisation du corps blessé. La valeur du corps ne fût jamais une évidence, et fût amenée à varier. Si aujourd’hui, il peut sembler logique de réparer un traumatisme crânien, un foie en bouillie, ou une décompensation post-traumatique, il n’en était rien à ces époques, où les connaissances du corps ne permettaient pas d’appréhender ce type de lésions. La réparation concernait uniquement ce qui était visible extérieurement du vivant de la victime, ou bien, dans certains cas, sur son cadavre. Dans ces contextes sociaux, les amputations étaient donc très logiquement le premier chef de réparation. D’autres critères intervenaient cependant. Par exemple, Platon demandait la réparation du préjudice esthétique, conformément à sa philosophie. Les hébreux versaient de l’argent en indemnisation de la douleur -nous trouvons là des origines au pretium doloris actuel. De surcroît, d’autres critères pouvaient modifier les modalités concrètes du processus de réparation : le rang hiérarchique ou social, l’âge, le sexe, le métier étaient le plus souvent pris en compte…
Ce premier type d’évaluation du « handicap » semble ainsi concerner quasi exclusivement les atteintes corporelles liées à la responsabilité d’un tiers. D’ailleurs, le fait d’avoir provoqué une lésion, d’avoir donné, coups et blessures pouvait être passible d’amendes, ainsi que d’avoir infligé l’humiliation d’être battu. Il semblerait donc que dans certaines contrées, le droit au respect de la face fût autant développé que le droit au respect du corps. Tout ceci amène à penser que la réparation forfaitaire n’avait pas comme finalité exclusive la réparation matérielle d’une lésion corporelle telle qu’une amputation du bras ou de la jambe. Il est bien évident que l’irréparable avait été commis et que rien ne saurait le réparer. Le versement d’un capital forfaitaire pour une perte corporelle irréparable avait probablement une visée fondamentalement sociale à ces époques : enrayer une surenchère de vendetta et restaurer une paix sociale fragilisée par l’incident. Ce risque social était loin d’être négligeable comme le met en exergue René Girard[2] : « La vengeance se veut représailles et toutes représailles appellent de nouvelles représailles. Le crime que la vengeance punit ne se conçoit presque jamais lui-même comme premier ; il se veut déjà la vengeance d’un crime plus originel. La vengeance constitue donc un processus infini, interminable. Chaque fois qu’elle surgit en un point quelconque d’une communauté, elle tend à s’étendre et à gagner l’ensemble du corps social. Elle risque de provoquer une véritable réaction en chaînes aux conséquences rapidement fatales dans une société de dimensions réduites. »
L’indemnisation du handicap ou l’indemnisation du manque à gagner
Au fur et à mesure des dévaluations monétaires, ces sommes forfaitaires finirent par perdre leur pertinence sociale : elles étaient devenues trop insignifiantes au regard de la perte corporelle subie. Puis le principe d’un corps humain libre, et par suite non susceptible d’être soumis à une évaluation de sa valeur émergea. Il fût notamment défendu par les romains et fût appliqué aux êtres humains n’ayant pas la condition d’esclave. C’est pourquoi la tarification des lésions devint dès lors impossible. A cette nouvelle compréhension-valorisation du corps et du handicap correspondit alors de nouveaux choix sociaux, telle l’indemnisation. Ainsi, l’indemnisation des séquelles corporelles reposa progressivement sur l’évaluation de préjudices économiques. Ce ne fût plus l’intégrité du corps qui fût prise en compte mais sa valeur en tant qu’instrument de travail, en tant que moyen de subsistance. Ce sont le manque à gagner présent et les pertes de gains futures, les frais générés par les soins médicaux qui seront indemnisés. Ainsi la société organisa en son sein la solidarité entre ses membres.
Ce type d’arrangement social autour de la solidarité s’est développé au départ dans des groupes relativement restreints, sous la poussée d’acteurs volontaires, notamment dans les corporations de métiers au moyen-âge. Chaque participant versait alors sa quote-part dans une caisse commune ou bien participait individuellement à une aide financière décidée collectivement lorsque l’un d’eux était dans la nécessité. L’objectif étant de permettre la subsistance, ce furent très logiquement des versements réguliers, parfois même des rentes, qui devinrent l’usage. Le fait que ce soit le groupe dans son ensemble qui prenne en charge chaque membre dans la difficulté, permettait des versements effectifs dans la durée.
Par ailleurs, les jugements pris dans les tribunaux participèrent également à définir une organisation de la solidarité. Ils furent à l’origine de la réglementation des accidents du travail et du traitement des invalides de guerre. Mais ce fût au moment de la révolution française que fût proclamée par la Constituante la notion de reconnaissance de la Nation envers les blessés de guerre. Ce principe s’affirmera, peu après, avec l’instauration d’un droit irrévocable à la pension de guerre dans l’article 86 de la constitution du 22 frimaire de l’an VIII. L’indemnisation des blessures de guerre devint donc un droit au sens strict du terme.
A la suite des mutilés de guerre, les accidentés du travail demandèrent une reconnaissance de leur situation. Ce sera l’un des objectifs premiers des luttes ouvrières au début de l’industrialisation. Les ouvriers obtiendront en partie gain de cause, tout d’abord en termes de jurisprudence, avec l’arrêt Teffaine. Cet arrêté rendu par la Cour de cassation en juin 1896, et concernant la mort accidentelle d’un ouvrier lors de l’explosion d’une chaudière, promeut une nouvelle forme de responsabilité pour l’employeur : une responsabilité sans faute prouvée. « Responsable mais pas coupable ». Cette tendance jurisprudentielle se verra renforcer par le vote et l’application de la loi du 9 avril 1898. Cette loi repose sur le principe fondamental du risque et non plus de la faute. Elle introduit de plus un nouveau concept pour définir la réalité du dommage corporel : le taux d’incapacité au travail. Ce taux fait l’état d’une réduction de capacité de travail qui est indemnisée forfaitairement. Il est fondé sur un postulat : la perte de gain serait proportionnelle à l’importance de l’incapacité physiologique
La réparation des préjudices corporels ou la compensation du handicap
Enfin, un dernier type d’évaluation du handicap naquit en droit commun. La réparation en Droit Commun repose sur l’article 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » La réparation du préjudice corporel en droit commun a ceci de particulier qu’elle doit être égale à l’intégralité du dommage. Il s’agit donc de compenser toutes les conséquences du handicap, principe qui est devenu quelques dizaines d’années plus tard un droit dans le cadre de la loi de modernisation sociale (art.53) en 2002.
Ce principe de réparation de l’intégralité du dommage corporel a amené progressivement, au fur et à mesure des plaidoiries et des procès, à une conception spécifique du handicap, qui n’est ni celle du droit des accidents du travail, ni celle de la sécurité sociale, ni celle de l’armée. Il s’agit de compenser l’intégralité du dommage corporel, et non uniquement la perte de revenus ou autre… Un premier barème droit commun[3], écrit en 1959 par le Professeur Pierre Arrivot, est publié dans un supplément du Concours Médical. Il s’agit avant tout d’un recueil synthétique des jurisprudences en cours, qui est présenté à titre expérimental. Son utilisation rendra de nombreux services. Cependant ce premier barème fut critiqué et donna matière à débats. D’autres propositions de barèmes virent alors le jour. L’évaluation ne concerna plus tant les lésions elles-mêmes que leurs conséquences séquellaires : la limitation des fonctions. Ainsi, le corps fût compris à cette époque comme un tout fonctionnel, le handicap comme une atteinte aux fonctions. Autre innovation : deux nouveaux chefs de préjudice s’autonomisent : le Pretium Doloris et le Préjudice Esthétique, avec, tous deux, une échelle de mesure de sept degrés.
Mais les réflexions et élaborations ne s’arrêteront pas là… En droit commun, les chefs de préjudices se sont multipliés. Leurs définitions ont varié au fil des plaidoiries, et l’accord entre les parties n’est que partiellement obtenu, toujours soumis à de nouvelles négociations.
Le handicap : objet de droits, objet de luttes sociales
Le handicap varie dans ses significations au fil de l’histoire. Dans l’Antiquité, il fut d’abord la raison de vengeances sans fin et donc l’objet d’une régulation des liens sociaux en faveur d’une pacification. Plus tard, au moyen-âge notamment, le handicap fût davantage vu comme la perte des moyens d’assurer sa subsistance et celles de ces proches. Il s’est donc agi d’organiser la solidarité. Au cours du XXème siècle, le handicap fût davantage appréhendé comme un ensemble de conséquences qui limitent la jouissance de la vie. Il s’est donc agi de réparer ou de compenser les conséquences de la survenue d’un handicap. Les droits sont alors devenus une pierre angulaire du rapport au handicap.
Cependant ces droits restent fragiles dans leur existence et dans leur effectivité. En effet, fruit de débats sociaux et d’analyses diverses, ils sont donc l’objet de controverses, de négociations et donc d’évolution. Ils ne sont pas donnés définitivement, imposés de manière transcendante. Aussi, en l’état des compréhensions contemporaines du handicap, celui-ci est-il paradoxalement tout à la fois la possibilité de bénéficier de droits et la nécessité de lutter pour leur mise en œuvre.
[1] Une première version de cet article, contenant davantage de précisions et d’analyses, a été publiée en janvier 2003 dans les Cahiers de Recherche du CREDOC.
[2] René Girard, La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972.
[3] Pierre Arrivot, Barème indicatif des invalidités en droit commun, in Le Concours Médical, supplément au n°48 du 28 novembre 1959.